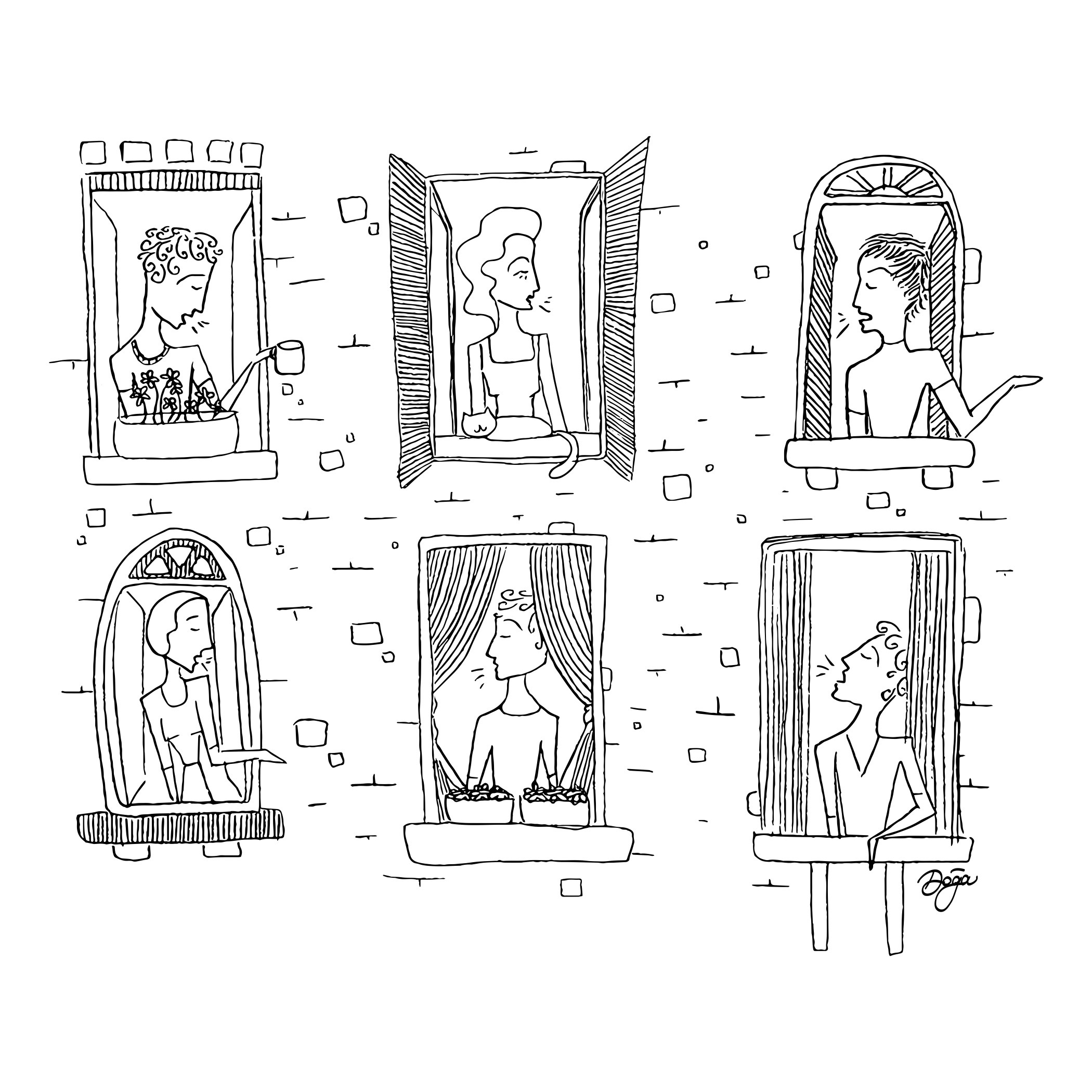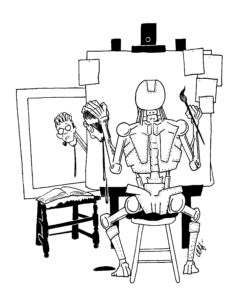Stéphane Zweig, écrivain autrichien du début du XXème siècle, s’est imposé sur la scène littéraire par son exploration des passions humaines, souvent destructrices. Dans une prose à la fois sobre et vivante, il capture l’intensité des tourments amoureux. L’obsession, centrale dans son œuvre, devient une force dévastatrice révélant les failles de l’âme…
L’obsession amoureuse chez Stefan Zweig n’est pas que le résultat d’une quête de l’autre ou du désir passionnel de le posséder. Elle ronge, elle consume, elle laisse les corps épuisés et les esprits ravagés : le sujet lui-même se retrouve en lutte. De fait, ses personnages, enfiévrés de désir, se perdent dans un tourbillon où l’amour n’est qu’un prétexte pour s’engager dans un combat solitaire, une lutte acharnée qui, en réalité, est une lutte contre eux-mêmes. Car l’autre, dans cet échiquier personnel, n’est qu’un miroir déformé de leurs propres failles, de leur incapacité à trouver la paix. Zweig ne se contente pas de peindre les contours d’une passion ; il dissèque l’intime, il dévoile l’érosion lente d’un être qui se défait sous le poids de son désir.
Effacement de soi : amour, sublimation et anéantissement
Abordons d’abord le processus subtil par lequel la passion amoureuse, souvent perçue comme une quête de fusion ou une aspiration à la possession de l’autre, est progressivement déconstruite. Chez Zweig, la passion ne se limite pas à l’irrationnel primaire. Elle devient une force méthodique, quasi scientifique, qui transcende les élans émotionnels pour infiltrer chaque fibre de la conscience. L’envie de posséder l’autre est transcendée au profit d’une dynamique complexe qui vient déranger les fondements mêmes de l’identité. La passion, détachée de son aspect brûlant, s’installe insidieusement chez Zweig, déstabilisant l’individu en le forçant à se confronter à ses désirs les plus enfouis, souvent jusqu’à l’autodestruction. Dans La Confusion des sentiments et Lettre d’une inconnue, Stefan Zweig explore deux visages de la fixation amoureuse, à la fois opposés et complémentaires dans leur mécanisme destructeur. Dans le premier, l’engouement de l’étudiant envers son professeur se manifeste par une quête intellectuelle dévorante et, ce qui apparaît au départ comme un désir d’excellence académique, est en réalité un besoin profond de reconnaissance, une tentative désespérée de se fondre dans l’autre, de se voir transparaître. L’étudiant canalise sa passion dans le travail, mais derrière cette façade d’ambition se cache une véritable pulsion de possession intellectuelle. « Il était rare qu’il me remerciât ; quand je lui apportais au matin le travail qui m’avait demandé une partie de la nuit, il se contentait de me dire sèchement : « Vous auriez pu attendre jusqu’à demain. » » Ce passage révèle la finesse avec laquelle la perte de soi se déguise en dévotion, masquant en réalité une volonté profonde d’anéantissement de soi dans l’autre. L’étudiant n’aspire pas uniquement à plaire ; en réalité, il s’efforce de disparaître dans l’idéal inaccessible de ce maître qu’il idolâtre. L’obsession intellectuelle devient alors une forme de sublimation, un feu latent qui consume chaque parcelle de l’âme sous l’apparente et nécessaire maîtrise de soi.
En contraste, Lettre d’une inconnue nous présente une histoire qui ne s’abrite plus derrière le masque de l’ambition ou de la quête intellectuelle, mais qui se livre à un sacrifice absolu. L’Inconnue, qui aime sans être aimée, vit dans l’ombre d’un homme qui ne la reconnaît jamais. Mais, à nouveau, cet amour n’est pas une quête de l’autre, c’est une annihilation volontaire de soi. « À toi qui ne m’as jamais connue. » Cette phrase résume tout : l’Inconnue (die Unbekannte) n’existe plus en tant qu’individu. Elle a sacrifié toute son identité pour un homme qui, même après l’avoir vue nue, ne sait toujours pas qui elle est. Elle est devenue un fantôme, une projection vide d’un amour unilatéral, sans désir propre, car elle n’existe pas dans le regard de l’aimé. Là où l’étudiant cherche encore à se fondre dans l’autre, l’Inconnue accepte sa disparition totale. De fait, son histoire n’est pas marquée que par l’absence de réciprocité amoureuse, elle est surtout une malédiction : la protagoniste est consumée tout entière par une illusion d’amour. Zweig nous montre ici que l’obsession, qu’elle prenne la forme d’une quête intellectuelle ou d’un amour sacrificiel, est une force irrésistible qui, finalement, est davantage révélatrice de la personne passionnée que par l’objet de désir.
Ici résonne la brutalité de cet amour. La question n’est pas d’être aimée en retour ou non, mais d’être consommée par une projection d’amour qui n’a jamais existé. Tout le monde parle d’amour réciproque, de ce rêve de l’autre qui comble nos manques. Zweig, lui, pose la question : et si l’autre ne te voit jamais ? Et si tu t’éteins dans cette quête interminable ? L’Inconnue, elle, n’est plus qu’une ombre, résolue à n’être que l’anonyme : elle est consumée, tout entière, sa vie offerte à l’absence.
Différemment, dans Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, le développement d’une passion est foncièrement lié à la destruction. De la même manière que l’inconnue se perd dans l’attente de l’autre, s’y dissout comme si elle n’avait plus d’identité, résolue à mourir sans reconnaissance de son amour et de son être, Mrs C., captivée par un jeune homme perdu dans le vice, se laisse aspirer par la chute de cet homme – elle se confond avec lui également. Elle n’est plus seulement attirée par lui ; elle est fascinée par sa déchéance, veut le sauver, comme dictée par la mission divine inculquée par la passion suprême. « J’étais fascinée par l’abîme où il semblait se précipiter. » Et cet abîme devient le sien. L’amour est annihilé, mis en second plan derrière une addiction à la perte, une fascination morbide pour ce qui détruit. Mrs C. croit qu’elle peut sauver cet homme, mais en réalité, elle ne cherche qu’à sombrer avec lui.
Zweig déchire le voile romantique pour exposer cette pulsion de mort qui se cache derrière le désir. Mrs C. n’a jamais voulu le bonheur, elle veut l’extrême, l’incontrôlable, l’autodestruction. Dans cet amour, il n’y a rien à sauver. D’une part, l’obsession est une chute libre dans le chaos. Parallèlement, le sentiment d’amour, qui ici n’est pas désir d’union, devient une pulsion suicidaire. Mrs C. n’aime pas cet homme. Elle aime sa ruine, elle aime l’idée d’être consumée à travers lui. Dans cet amour-là, il n’y a ni lumière de la rencontre, ni réconciliation de l’être avec lui-même. Pour l’inconnue, l’amour total ne conduit pas non plus à la lumière, il conduit progressivement à la destruction tangible de son identité et de sa vie.
Culpabilité et obsession : une spirale sans issue
Pourtant, comme le déploie largement Zweig dans ses récits, l’on ne peut échapper au miroir et à l’image de soi qui y transparaît. Cela, il le soutient dans La Pitié dangereuse, son seul roman où l’obsession et la culpabilité sont inextricablement liées, tissant une toile complexe autour des émotions d’Anton Hofmiller. La première rencontre du personnage avec Edith de Kekesfalva, marquée par une maladresse qui le pousse à l’inviter à danser sans soupçonner son handicap, déclenche une spirale de culpabilité qui le hante sans relâche. Cette culpabilité se mue en passion, un besoin irrépressible de réparer, de veiller sur le bonheur d’Edith, jusqu’à l’effacement de soi. Hofmiller oscille entre pitié et amour, perdant toute distinction entre les deux, piégé dans un dilemme moral où son désir de rédemption lui interdit d’agir avec sincérité. Il se retrouve enchaîné par ses propres sentiments, confondant le poids de la culpabilité avec une forme d’amour sacrificiel : « Je n’étais pas seulement son ami, mais j’étais aussi celui qui avait blessé son âme, et je me sentais responsable de chaque larme qui coulait de ses yeux. » La culpabilité devient ici le pivot de la passion dévorante.
Ce ne sont pas l’adultère ou la pitié qui hantent véritablement ces personnages, mais surtout les vérités qu’ils enterrent, lesquelles finissent par les révéler à eux-mêmes. Pour fuir cette révélation insupportable, ils bâtissent la cage de leur propre emprisonnement, une prison indestructible, alimentée par l’effroi de se voir démasqués, de se retrouver dans le regard des autres, dépouillés des masques qu’ils ont façonnés pour se protéger. Ainsi, l’adultère et la pitié ne sont que des résidus, les échos d’une souffrance plus ancienne, enracinée dans la culpabilité. Malgré tout, les personnages se sentent obligés de maintenir leur illusion de maîtrise, alors même que, imperceptiblement, tout s’effondre déjà autour d’eux.
L’obsession amoureuse chez Stefan Zweig se présente comme une lente agonie qui consume l’âme et le corps dans une quête inépuisable de sens et d’identité. Elle dépasse l’élan vers l’autre, s’écartant de la volonté de sublimer ou de posséder, car le véritable objet de la passion devient le soi, égaré dans les sillons passionnels. En effet, elle prend racine dans une quête de soi vouée à l’échec, où l’être se heurte invariablement à l’effacement, à la destruction, à la culpabilité ou à une sublimation stérile. Zweig, avec une précision chirurgicale, expose les veines empoisonnées de l’amour compulsif : il n’est jamais chemin vers le bonheur, mais condamnation sentencieuse. Dans cette descente alors, l’individu se perd inexorablement, pris au piège d’un amour sans résolution. L’obsession, surtout, le force à un face-à-face implacable avec lui-même : qui est-il, en vérité, derrière les rouages implacables de sa compulsion ? Elle lui arrache ses masques, l’oblige à sonder l’abîme de son propre désir, à affronter cette part obscure, insatiable, qu’il ne veut pas voir. Dans ce jeu de miroirs déformants, la passion le pousse à chercher celui qui se cache sous l’apparence, l’homme qu’il redoute de découvrir, celui qu’il tente de fuir.
Illustration : Mila Ferraris
Texte : Diana Carneiro