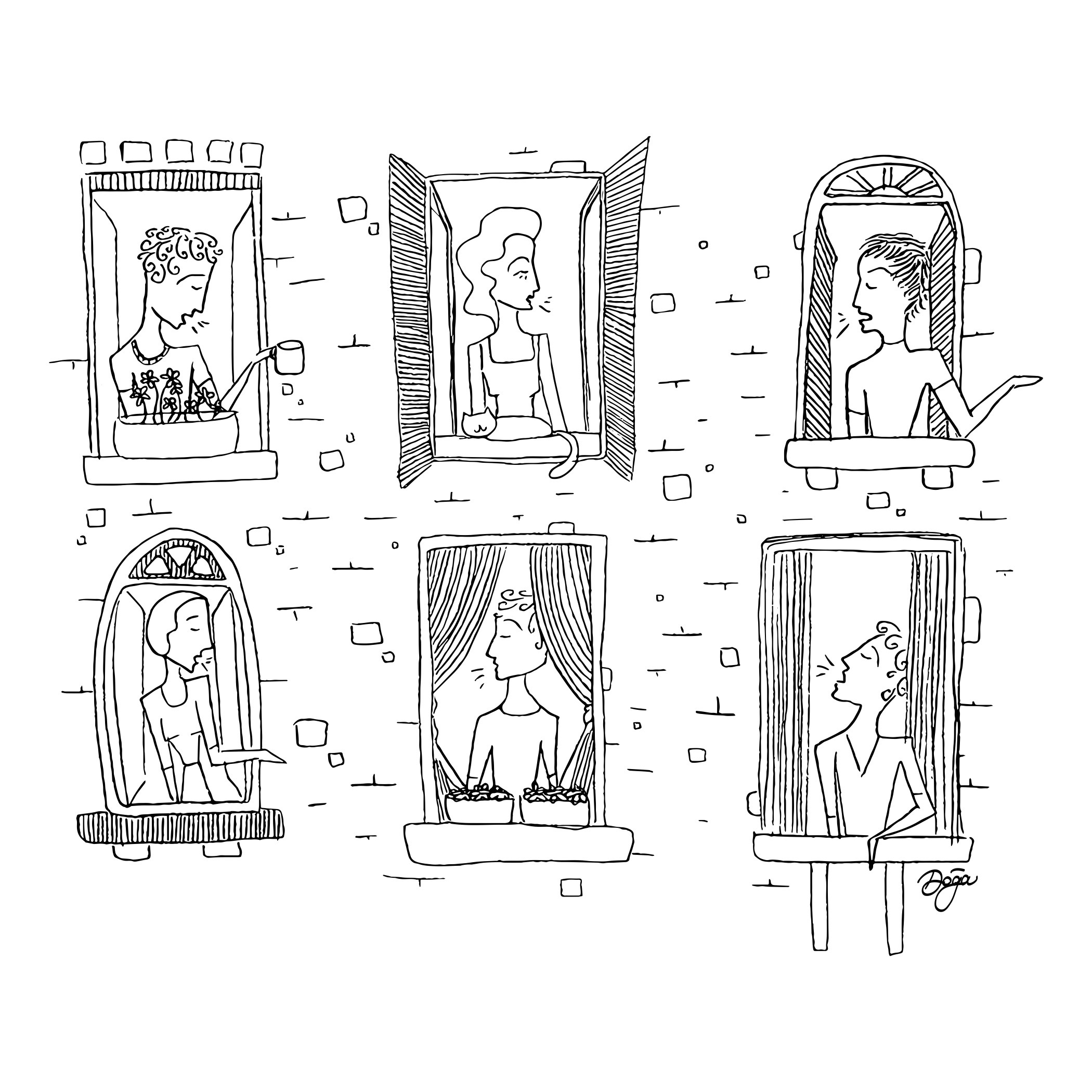Les secondes défilent, oppressent et tordent les cœurs noués qui scandent en écho le fracas insoutenable à venir. Huit heures quatorze, quinze. Hiroshima. Puis… le silence.
L’uranium a arraché au monde entier un silence sonore et fracassant. Parce que oui, le silence n’est pas qu’une absence de bruit venant interrompre le brouhaha du quotidien. Il est une présence à part entière, dense et polysémique, qui se manifeste autant par ce qu’il tait que par ce qu’il révèle. Parcourant les recoins de l’indicible, il s’illustre comme vide fertile et rassemble. Souvent déprécié ou effrayant, il donne pourtant accès à un état libérateur et propice à la création où les idées s’articulent et les émotions prennent forme.
Le vide comme outil créateur
On se cache souvent derrière le martèlement des rythmes quotidiens, persuadé.e.s que l’agitation alimente la pensée et inspire. De ces palpitations émanent des réflexions et des idées à foison que l’on gobe de façon presque industrielle.
Pourtant il est temps de disséquer ce vide tant redouté, capable de transformer l’artiste et son œuvre, en les abrogeant des tensions liées au processus créatif. L’inspiration autrefois noyée dans le bruit recouvre sa pleine dimension et tisse de nouveaux univers. Il offre une page blanche presque immaculée, un prélude à l’action de laquelle peut surgir un coup de pinceau, lettres ou notes funambules. Loin d’être un obstacle, la clarté qui en émane s’illustre comme une réelle présence prolifique.
La surdité inexorable de ce grand compositeur n’a pas su freiner son effusion artistique. Pourtant destiné à une obscurité sonore macabre et désolante, Beethoven l’a exploitée dans ses moindres recoins et transformée en bouillonnement inventif. En s’aidant des vibrations, il compose certaines de ces œuvres les plus audacieuses comme la Neuvième symphonie. Ce qui aurait pu être une condamnation devient alors une légende : celle d’un compositeur qui, paradoxalement, écoute le silence mieux que personne.
Le silence, une expérience collective
Différemment, il ne faut pas donner au silence une chance d’enfoncer le mythe de l’artiste ermite et solitaire que l’on connaît par cœur. Il est commun à tous.tes et se rapproche davantage d’un moment de partage que d’une expérience individuelle. Ce socle est ancré dans notre « mémoire collective » jungienne, comme une sorte de bagage mémoriel acquis dès la naissance. On dispose ainsi tous.tes d’un même langage, incluant un silence aux qualités polyglottes.
Se taire, s’abandonner, s’abstraire pour estomper les différences et créer une toile unitaire. Dès lors, le non-verbal revêt une puissance jusqu’ici insoupçonnée. C’est une expérience active commune ayant trait plutôt à l’écoute de l’autre qu’à une absence infructueuse. À l’écran, au théâtre, dans une salle de concert ou sur une place publique, il impose un moment d’unité. Seuls les battements du cœur résonnent alors qu’aucun autre bruit ne se fait entendre, comme une réelle communion.
Ces pauses universelles révèlent ainsi une puissance mémorielle inégalée, l’écoute témoignant de respect et d’une réelle considération envers un événement ou une personne. Souvent associée à la mort ou l’horreur, elle implique à l’inverse une certaine neutralité dans ces instants de contemplation, qui gomme les tensions nous divisant pour un combat commun vers la perpétuité. Ce silence est actif, presque bavard : il parle d’écoute, de respect et de renouvellement mémoriel. Il dépasse les frontières culturelles, créant un langage universel que tout le monde peut comprendre.
Indicibles
Le silence nous apparaît alors comme un nouvel alphabet, nous permettant d’évoquer des choses d’une instance autre, appartenant au domaine de l’indicible. Dans ses thèses sur le langage, Bergson montre les limites du verbal et les difficultés qu’il rencontre pour capturer l’essence même des expériences intimes et ressentis. On se contenterait des étiquettes posées sur les choses sans les saisir en profondeur. Les flots de mots perdent alors de leur superbe pour redorer en contrepartie le silence et son humilité, capable lui, d’atteindre l’ineffable. La puissance d’une pause dans un discours solennel ou d’un soupir valent plus qu’un assemblage de lettres déstructuré.
Le cinéma a décidé d’allier images et sons, comme si le visuel ne suffisait pas. Pourtant muet dans ses débuts, l’ajout des bruitages s’explique sans doute par des pulsions grandiloquentes et des envies insatiables d’immensité. Et pourtant, c’est face à la scène de téléphone entre Harry Dean Stanton et Nastassja Kinski que nous sommes sortis bouche bée des salles projetant Paris, Texas en 1984, l’image triomphant sur le son, et le regard sur les lèvres. Pas de grandes tirades ni de musique de fond, seulement des regards et cette absence de mot iconique. C’est ce vide sonore qui rend la scène inoubliable – et son esthétique aux teintes saisissantes bien sûr.
Le silence devient le langage principal, un outil narratif révélant des émotions brutes et universelles que les dialogues tendent à alourdir. Levier à la création et au partage, il serait malheureux d’oublier ses vertus dans nos sociétés bruyamment oppressées. Plus qu’une absence, il est une présence essentielle, propice à la création, à l’unité et à la contemplation.
Raphaëlle BOULLET
Illustration : Dōga