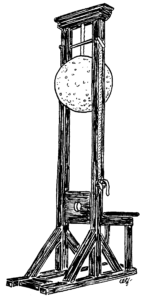Photographe de renom à New York, Gregory Crewdson parvient à capturer au sein de son œuvre la réalité désenchantée des quartiers et foyers américains, à travers des mises en scène presque cinématographiques, interrogeant nos propres illusions sur le monde qui nous entoure.
« Je cherche à construire un monde parfait et je n’y arrive jamais tout à fait »
Gregory Crewdson
En apparence, il ne se passe rien. L’image est étrangement silencieuse. Aucun mouvement. Et pourtant, dans ces paysages désolés, tout semble porter la trace obsédante du traumatisme. Celui qui s’est aventuré cet été à la Mécanique Générale, à l’occasion de la cinquante-troisième édition des Rencontres photographiques d’Arles, n’aura pas pu passer à côté de la trilogie Eveningside – 2012-2022, qui rassemble une décennie de création du photographe Gregory Crewdson. L’artiste, notamment célèbre pour sa magistrale série Dream House réalisée en 2002, qui mettait en scène les actrices Julianne Moore, Tilda Swinton et Gwyneth Paltrow dans des maisons suburbaines typiques de la middle-class américaine sur fond d’un symbolisme inquiétant à la David Lynch, a pour coutume de déployer un attirail hollywoodien pour la réalisation de ses photos. Résolument cinéphile, quasi-cinéaste, il réserve une – très – longue étape de post-production à son processus de création, composant ainsi des images immenses, nettes sur tous les plans, de véritables organismes où chaque partie contribue au fonctionnement poétique du tout.
En filigrane de ce geste artistique démiurgique – mais qui ne se proclame jamais comme tel – résonne une angoisse, un grésillement lancinant dont on ne trouve pas la source, espèce d’inquiétante étrangeté (après tout, Crewdson est fils de psychanalyste) qui ne donne jamais son nom. Dans la trilogie qui nous occupe, Crewdson montre une Amérique suburbaine du Massachusetts aux allures mortifères de terrain vague. Au milieu de ces banlieues désindustrialisées, des femmes et des hommes, comme plantés là, scrutent d’un regard impuissant un horizon sans promesse, souvent hors-champ. Parfois, ils sont deux protagonistes sur la photo : dans un living-room, une chambre, une voiture. Mais les regards ne se croisent jamais : des solitudes agrégées, qui semblent contempler leur désillusion. Celle d’un American Dream déçu, ou désenchantement plus métaphysique, en tout cas, Crewdson tisse au fil des photos le récit d’existences modernes aux prises avec une réalité déceptive. Outre le fait que l’œuvre de Crewdson thématise, du moins suggère la perte douloureuse des illusions, l’acte de création lui-même paraît mû par un mouvement dialectique perpétuel entre la quête d’un idéal et sa perte. De l’impulsion créatrice à l’œuvre finie se laisse entrevoir en toile de fond une négociation, laborieuse mais féconde, de l’artiste – et a fortiori, de l’homme –, avec le réel.
Chimères américaines (1)
Pittsfield, Massachusetts. C’est la bourgade qu’a choisie Gregory Crewdson pour sa série An Eclipse of Moths (littéralement « une éclipse de papillons de nuits »). Laissée exsangue par le départ de la compagnie General Electric au début des années 1970, elle incarne l’Amérique post-industrielle des laissés-pour-compte, le revers dérisoire des promesses de prospérité de l’American Way of Life. Sur l’une des photos, un immense parking désert. Deux caddies rouillés, un vieux téléviseur, un vélo à l’abandon. À l’avant gauche, un homme âgé, torse nu, debout, le regard plongé dans une flaque d’eau à ses pieds. Au fond, deux adolescents adossés à une sorte de mobil-home, au sol ce qui semble être un tas de déchets. Et au centre, un bâtiment qui porte la cynique inscription « Redemption Center ». Ces photos, Gregory Crewdson les définit comme « une méditation sur la cassure » (brokenness), « une recherche, un désir, une aspiration au sens et à la transcendance ». On y trouve quelque chose de semblable à ce que le dramaturge belge Maurice Maeterlinck nommait le « tragique quotidien » (Le Trésor des humbles, 1896), c’est-à-dire un tragique qui loge dans la nature de l’existence elle-même lorsque celle-ci est manquée, insatisfaite, désincarnée. De ce motif est née toute une tradition artistique et littéraire qui, tout au long du XXe siècle, a compris la condition humaine en les termes d’une expérience de désoeuvrement.
Si le prisme paraît nihiliste, il est surtout une source poétique intarissable, dans laquelle Crewdson ne cesse de puiser. La série Eveningside (2021-22), qui suit An Eclipse of Moths et clôture l’exposition, intègre ce symbolisme de manière plus explicite encore. « Eveningside », ville fictive, est capturée en noir et blanc, autorisant des clair-obscurs oniriques qui contribuent à faire de ces images un véritable univers mental. Par trois fois, Crewdson met en scène une femme enfermée dans une vitrine face à un miroir, de sorte à voir à la fois son corps et son reflet. Quête de réel, de la frontière entre soi et le monde… Crewdson nous place continuellement dans l’inconfort existentiel de ne jamais savoir si nous sommes tout à fait au monde.
En marge de ces tableaux de la ruralité américaine, il y a Fireflies, sorte de préambule qui ouvre l’exposition. La série détonne de façon surprenante avec la trilogie qui suit : des paysages nocturnes, une forêt, assaillis par des centaines de points lumineux ; des lucioles. Crewdson la réalise seul, en 1996, peu après une séparation amoureuse terrassante. Le résultat est étonnamment tendre. Pourtant, lorsqu’il les développe, la désillusion artistique est totale, il enferme les négatifs dans une boîte qu’il ne rouvrira que dix ans plus tard. Eveningside 2012-2022 est la première exposition qui rend Fireflies accessible au public. Et de fait, la série fait exception dans l’œuvre du photographe : adepte du contrôle absolu, fasciné par l’image fixe, son geste artistique est quasi psychorigide. « Je suis terrifié à l’idée que les images puissent bouger », confie-t-il au curateur d’Eveningside, Jean-Charles Vergne (2), lorsque celui-ci lui demande ce qui le retient de passer de la photographie au cinéma. Crewdson ne revient pas, après Fireflies, à des productions ainsi improvisées. Mais il ne cesse de mobiliser les désillusions, intimes, collectives, sociales, métaphysiques, dans sa pratique artistique. Manière, sans doute, de ne jamais quitter le terrain de l’indéterminé et de l’irrésolu.
Sascha SAIS
Illustration : Mila Ferraris
(1) : L’expression est empruntée à l’ouvrage d’Amélie Galli et Judith Revault d’Allonnes, consacré à Todd Haynes (De l’incidence Éditions, mai 2023).
(2) : Entretien entre Charlotte Pudlowski et Jean-Charles Vergne, Podcast « Pépites », 27 juillet 2023